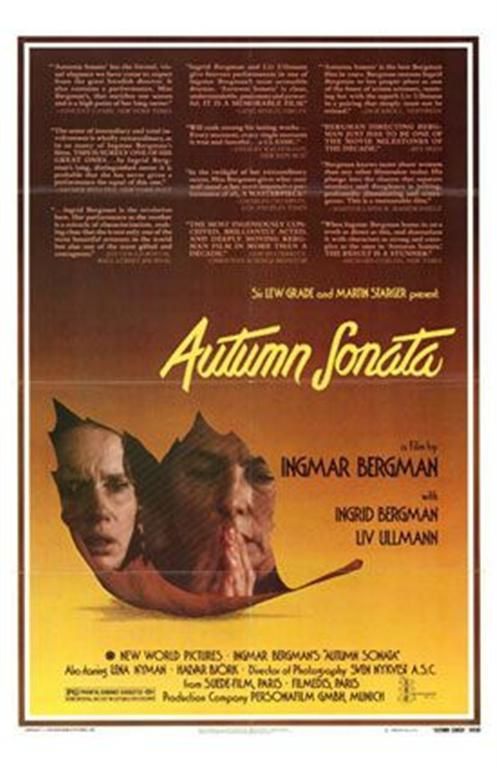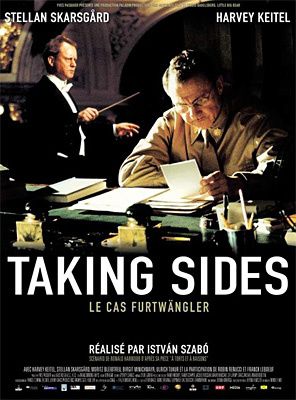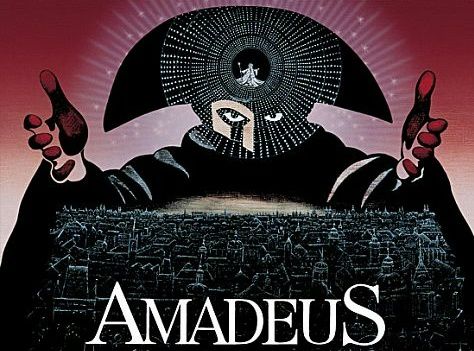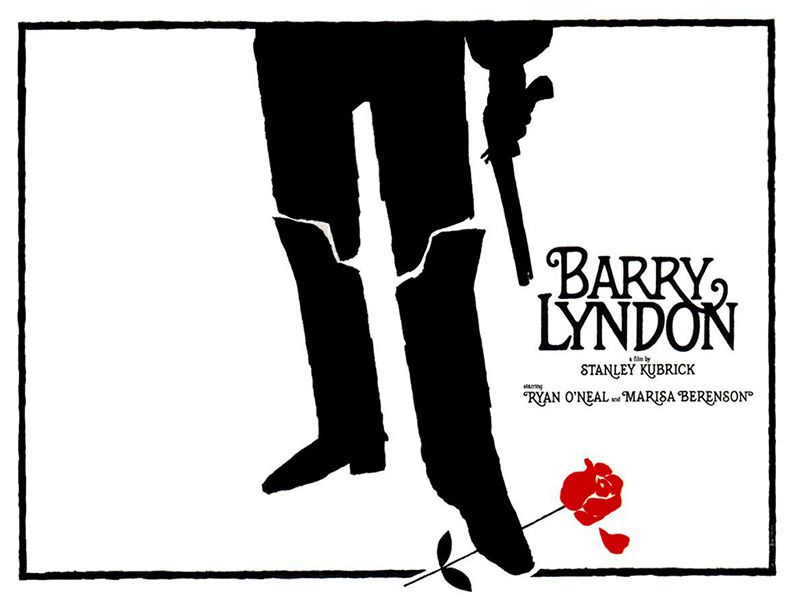Je retranscris ici un dialogue du film de Roger Vadim (1928-2000), Les Liaisons dangereuses 1960. Les dialogues sont de Roger Vaillant. Mme de Merteuil y est incarnée par Jeanne Moreau (*1928) et Valmont par Gérard Philipe (1922-1959).
On y retrouve une Mme de Merteuil, que l’on appelle par son prénom, Juliette. Les Juliettes dans les films de Vadim sont des femmes qu’il vaudrait mieux ne pas approcher, qu’on pense à cette autre Juliette incarnée par Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme… Juliette, donc, a épousé Valmont, qui lui n’a pas de prénom. Ils forment un couple libéré qui trouve son plaisir dans le partage de nombreuses aventures. Le style diffère cependant, Valmont est direct et serait banal sans Juliette à ses côtés, qui apporte une certaine touche de raffinement. Elle obéit à ses « principes » : jamais plus d’un amant à la fois. Elle est même une femme fidèle, puisqu’elle ne trompe un amant avec quiconque, pas même avec son mari.
Jeanne Moreau est cruelle à souhait, et on dirait bien qu’elle ne connaît aucun sentiment que la jalousie. Elle goûte avec délectation aux plaisirs d’un esprit qui domine son monde… Et Gérard Philipe campe le Valmont bien pris à son jeu, tant lorsqu’il séduit Mme de Tourvel que lorsqu’il provoque inutilement sa femme en faisant bien valoir comme Jerry Kurt, son amant, l’a oubliée.
Nietzsche nous dit qu’il faut « mourir à temps », eh bien, voila un film qui arrive à temps pour consacrer la mort d’une époque. On peut y voir une transposition à l’époque moderne d’un roman du XVIIIème. Mais n’est-ce pas aussi la transposition d’une époque en période de transition à la modernité du XVIIIème siècle ? Car que vont faire les mœurs après les excès de Valmont et Merteuil ? Elles vont s’assagir. La Révolution, certes, mais les Tricoteuses n’ont pas idée des plaisirs raffinés que seul l’esprit sait dicter à la chair.
1960, on peut encore imaginer Cécile jeune fille « pure », envisager son mariage en blanc, on peut encore voir cette société bien pensante marier sa jeunesse et perpétuer ses codes. Plus pour longtemps. Mais rassurons-nous ! La société bien pensante existe encore, elle est toujours aussi avide de commérages, toujours attirée par ce qui brille, et puis il lui reste toujours la bêtise. Seulement, soulignons que nous avons là un spécimen d’une espèce quasi-éteinte, la mère bien pensante mariant sa fille pure-et-de-bonne-famille. Admirons donc la chronique d’un monde en déclin, délectons nous d’une stupidité et d’une vénalité qui pouvaient encore se réclamer de la morale.
Ouverture :
Un monsieur âgé :
- Le noir lui va.
Une dame :
- D’où sort elle ?
Le même monsieur :
- Noblesse de Touraine.
Un ancien condisciple de Valmont raconte :
Un ancien condisciple de Valmont :
- Elle arrivait de sa province. Elle portait des petites robes très simples. Elle semblait toujours marcher en bottes et cravache à la main. Nous avons été tous amoureux d’elle. Elle sortait très librement avec les garçons. A la fin de la première année, chacun jurait qu’il l’avait eue. Mais comme personne n’a réussi à le prouver… On a cessé de se vanter, par crainte d’être ridicule.
Une dame :
- Au fond, elle était aussi sage que maintenant ?
L’ancien condisciple de Valmont :
- Qui ne le saura jamais ? Lui peut-être…
Deux dames parlent de Valmont et Juliette
Une dame :
- Mais ou l’a-t-elle connu ?
Une autre dame :
- Aux Sciences politiques : il l’a épousée l’année où il a passé le concours.
La dame :
- Et que fait-il aux Affaires étrangères ?
L’autre dame :
- Il attend d’en sortir. Côté père, La M* de Moselle. Côté mère, Banque des Affréteurs réunis.
Deux messieurs discutent
Un monsieur :
- Je ne comprends pas, cher ami, pourquoi on nous a invités dans cette jolie maison si parisienne ?
Un autre monsieur :
- Elle veut obtenir pour son mari une mission au près de l’OMAPA.
Le premier monsieur :
- Je croyais ce jeune homme plus occupé de la conquête des femmes que de celle des commissions de l’ONU.
Le second monsieur :
- Elle a de l’ambition pour deux.
Un monsieur et une dame parlent de Valmont et Juliette.
Le monsieur :
- Pourquoi l’a-t-elle épousé ? Pour l’argent du papa ?
La dame :
- Je ne pense pas. A mon avis, elle voit beaucoup plus loin.
Une tierce personne :
- Mais de qui parlez-vous ?
La dame :
- Comme tout le monde ! Des maîtres de maison, de Valmont et de sa femme Juliette.
Juliette et Trevor, un collègue de Valmont.
Trevor :
- Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Juliette :
- Mais je vous aime bien Trevor.
Trevor :
- Ce « bien » me crève le cœur.
Juliette :
- Vous avez un cœur ?
Trevor :
- Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Juliette :
- Vous devriez lui être reconnaissant : c’est rare aujourd’hui d’avoir un cœur.
Trevor :
- Je le remercie…
Juliette :
- En lui prenant sa femme.
Valmont s’immisce dans une conversation entre une Comtesse et sa cousine, Mme de Volanges.
Valmont à la Comtesse :
- J’ai skié l’année dernière avec le Comte votre mari. Vous n’étiez pas là malheureusement.
Mme de Volanges :
- Il est très rapide.
Valmont :
- Ma cousine vous a prévenu ? De ne pas croire un mot des gentillesses que je vais vous dire ?
Mme de Volanges :
- Il contre-attaque.
Valmont
- Ah ! Quel portrait vous a-t-elle fait de moi ?
Mme de Volanges :
- Je vous ai reconnu une très grande qualité.
Valmont :
- Ce n’est pas possible !
Mme de Volanges :
- Votre femme, Juliette. Elle est le contraire de vous : fidèle, droite…
La comtesse se détournant :
- Eh bien, je vous laisse en famille…
Mme de Volange :
- J’ai une grande nouvelle à vous annoncer…
Changement de plan.
Un monsieur âgé :
- Elisabeth sauvez moi la vie : emmenez moi parler !
Retour à la conversation entre Juliette et Trevor.
Trevor :
- Vous n’avez jamais envie de vous venger ?
Juliette :
- Pourquoi ? Regardez autour de vous : toutes les femmes s’ennuient autant avec leur amant qu’avec leur mari. Avec Valmont, je ne m’ennuis jamais.
Trevor :
- C’est bien ma chance ! Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c’est la seule dont je sois amoureux !
Le téléphone sonne.
Juliette :
- Un conseil Trevor : essayez d’aimer Loulou du Chemin.
Juliette va répondre au téléphone. Elle croise Valmont.
Valmont :
- Dis… Si c’est encore elle…
Juliette :
- Je sais.
Au téléphone avec Loulou du Chemin.
Juliette :
- Allô, oui ?
[…]
- Oh non Loulou ! Je ne peux pas déranger Valmont pour l’instant.
[…]
- C’est ça, il est en conférence.
[…]
- Bon, très bien, je ferai la commission.
Dans une pièce annexe. Valmont rejoint Juliette. Elle regarde un portrait d’elle d’un air songeur.
Valmont :
- Juliette Valmont ne reconnaît plus Juliette de Merteuil ?
Juliette :
- Si, mais j’ai peur de ne plus me plaire.
Valmont :
- Tu as des ennuis ?
Juliette :
- Je m’ennuie !
Valmont :
- J’avais l’impression que… Trevor…
Juliette :
- C’est un de tes collègues ! J’ai des principes !
Valmont :
- Et ton Américain, Jerry Kurt ?
Juliette :
- Il ne m’amuse plus.
Valmont :
- Alors, le Nouveau monde ? La saison de santé ? C’est déjà fini ?
Juliette :
- J’avais cru découvrir Tarzan…
Valmont :
- Tu as rompu ?
Juliette :
- Pas encore. Je cherche la manière. Le style de la rupture, c’est tout le charme des liaisons.
Valmont :
- Moi, tu connais mon style : pas de bavure : je te voulais, je t’ai eue. Adieu !
Juliette :
- Moi, j’aime fignoler.
Valmont :
- L’idéal serait de le marier. Casanova trouvait un mari pour les maîtresses dont il était l’amant.
Juliette :
- Ce serait piquant.
Valmont :
- Que penserais-tu de… Cécile ?
Juliette :
- J’y ai vaguement pensé. J’avais même un peu préparé le terrain : « je vais vous présenter la vraie jeune fille française ». Seulement Cécile est tout de même trop sotte, même pour Kurt. Remarque… Si j’avais insité…
Valmont :
- Ce serait fait ?
Juliette :
- Naturellement !
Valmont :
- Hé bien c’est fait !
Juliette :
- Quoi ?
Valmont :
- Oui. La Volanges vient de m’apprendre la nouvelle. Coup de foudre, déclaration, acceptation, fiançailles. Cécile et Kurt se marieront le printemps prochain.
Juliette :
[Rire forcé]
- Ah ! C’est trop drôle !
Juliette va rejoindre Mme de Volanges, qui se sert au buffet, au salon.
Juliette :
- Valmont m’apprend à l’instant la grande nouvelle…
Mme de Volanges :
[S’excusant au près d’une convive, se tourne vers Juliette]
- Mon chéri ! Vous êtes un peu la marraine de ces fiançailles.
Juliette :
- Ca, je ne croyais pas si bien réussir en les présentant…
Mme de Volanges :
- Il est très bien vous savez... Un Américain de la nouvelle génération. Très sensible à tout ce qu’il y a de délicat chez nos jeunes filles.
Juliette :
- Il apprécie beaucoup la France…
Mme de Volanges :
- Il a des opinions très personnelles. Il pense que les épouses américaines sont les plus sages du monde, mais, leurs jeunes filles font les quatre cent coups dès l’université. En France, c’est le contraire.
Juliette :
- C'est-à-dire que les femmes sont légères.
Mme de Volanges :
[L’air compatissant]
- Oh ! Ne lui en voulez pas ! Il nous jugerait tout autrement si toutes les Parisiennes étaient comme vous ! Vous ne le connaissez qu’à peine…
Juliette :
- A fleur de peau.
[Mme de Volanges a l’air troublé, Juliette ajoute :]
C’est une expression de Valmont.
Mme de Volanges :
[Reprenant, toute à son discours]
- Kurt est très enthousiaste. Oh ! Il ne tarit pas : une vraie jeune fille, innocente, candide, pure…
Juliette :
- Il a du vocabulaire… Et Cécile ? Au fait, pourquoi ne l’avez-vous pas amenée ce soir ?
Mme de Volanges :
- Eh bien, elle tenait beaucoup à aller chez une de ses camarades… Une surprise-partie.
Juliette :
[Prétendument indignée]
- La vraie et la pure jeune fille dans une surprise-partie ?
Mme de Volanges :
[Enfournant une petite saucisse dans sa bouche]
- C’est chez les d’Alembert. Ils donnent une petite fête dans leur hôtel de Neuilly pour les dix-huit ans de Chantal.